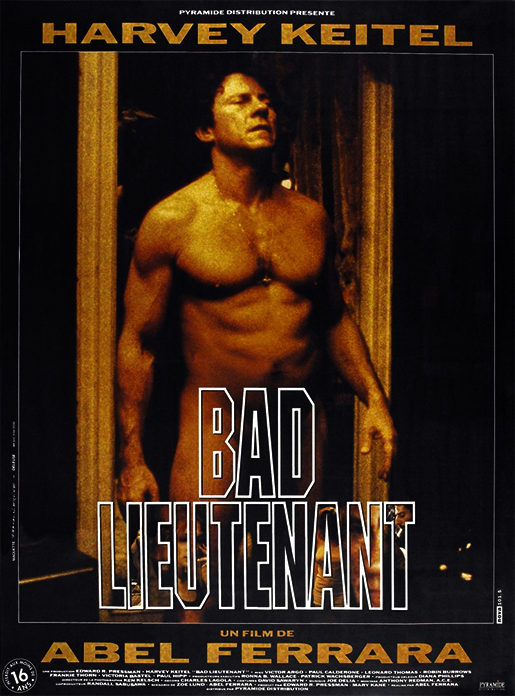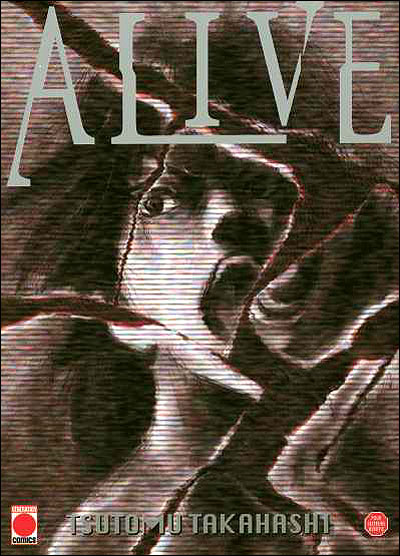|
| Harry Potter ? Non, Hugo Cabret |
Un
background carte postale
Paris. Ses goguettes, ses
épiceries, ses bérets (pas verts, oh que non)… Celui rêvé et
fantasmé de tous les américains. Celui de l'avant-guerre
(2nde), le vieillot, le rustique, le pittoresque. Au cinéma, dans
les jeux vidéo, partout... Paris est resté bloqué à un « âge
d'or » dans l'inconscient collectif. De Ratatouille à The
Saboteur en passant par Amélie Poulain... Celui qui fleure bon le
chamarré, l'huile de moteur, le jasmin et les épices. Un Paris des
faubourgs, pas encore trop colossal, typique du triple A français,
charmant, synthétisant le rural et l'urbain. Sa population, affable
et accueillante, populaire, ses commerçants serviables, ses
autochtones débonnaires, goguenards, pas encore touchés de plein
fouet par le formatage industriel de la Grande Amérique, et bien
sûr ses femmes soumises... Oh pardon.
 |
| Le Paris hivernal de Scorsese |
Tâche
2 en 1 : plus blanc que blanc ?
Hugo
Cabret, ou comment réaliser deux films en un. Comment introduire un
hommage vibrant à Méliès sans pour autant réaliser un
documentaire fondamentalement barbant, peu vendeur, et pas du tout
« business ». Attendez donc de voir le tapis se dérouler,
sous les pieds du petit Oliver Twist des quartiers chocs, endimanché d'une
pelure pour braver la neige, les assauts du temps et du travail qui
le crèvent. Préparez vos larmes, votre « âme d'enfant »,
pour vous émerveiller de situations de pacotille, d'allers-retours
incessants pour creuser le background du Paris carte postale d'Amélie
Poulain façon années 30, où l'amour donnera réponse à tout, de
toute manière, et finalement rendez-vous compte qu'il ne se passe
rien pendant une heure, jusqu'à la résolution de la première
intrigue. Débute alors LE vrai film, celui pour quoi Scorsese a
lancé la machine à vapeur, celui qui n'aurait pas été
« bankable » en ces périodes de fêtes, de son amour
pour Méliès, qui passe bien évidemment par l'intermédiaire d'un
personnage, éminent professeur chercheur dans une non moins
prestigieuse université parisienne... Et qui fait la connaissance
des gosses des rues, et de leur amour immodéré et réciproque (bien
que soudain), pour ce qui semble être la clé de la deuxième
intrigue du film, lancée tambour battant.
 |
| Indice : le nom de ce type essayant de ne pas voir flou en regardant de la 3D commence par un M. |
Vous
reprendrez bien de la 3D ?
Je
me disais bien que ça commençait mal, avec cet écran
d'introduction placé en interstice, composé de lettres capitales
grises et épaisses, servant à mettre en valeur la 3D, mais faisant
monstrueusement film d'action de seconde zone... Parlons-en,
justement, de la 3D. Gênante, encore une fois, elle ne met pas en
valeur toutes les scènes, et donne la curieuse impression de voir
des collages et aplats de papier sur un fond fixe, un peu comme dans
un Paper Mario où les figures plates se superposent au décor. Reste
que certains effets sont convaincants, comme la neige qui voltige,
mais il subsiste (à mes yeux) toujours la désagréable impression
de voir du leurre, du faux, et de ne pas vivre une expérience aussi
« traumatisante » qu'a pu être la démocratisation du
cinéma à l'époque.
Je n'y vois finalement qu'un argument cosmétique pour
augmenter le prix du billet, et qui par ses contraintes (les
lunettes, les défauts visuels), finira inexorablement par
disparaître, du moins dans sa forme actuelle, purement marketing. Il
n'est pourtant pas dit qu'elle ne subirait pas d'évolution, pour
devenir « instantanée », sans périphérique.
 |
| "Wesh, t'as vu cousin, j'suis trop chanmé et j'dégaine du Colgate au centième de seconde" |
Le
péril de vouloir trop bien faire
Des
enfants stars, le cinéma en a enfanté des tas. Mais quand ces mêmes
enfants ne se sentent pas assez propulsés, ils surjouent, en font
trop, veulent se faire une place à prix d'or. C'est le cas de Chloe
Moretz, qui colle 36 expressions à la seconde à sa carrière
d'actrice. Horripilante, elle monopolise l'attention par ses
singeries, quand son comparse Asa Butterfield (Hugo Cabret) se
débrouille plutôt bien dans le registre « oh, je suis un
pauvre petit sans racine, aidez-moi ! » vaillant et
débrouillard.
Aussi, c'aurait
été bien de prendre du plaisir à retrouver Sacha Baron Cohen dans
un autre rôle que celui qu'il s'attribue trop souvent : le
bouffon de service. En campant un chef de gare, il donne à voir une
autre facette, moins fofolle, moins beauf, plus reluisante, mais
toujours comique et burlesque, car on ne se refait pas. En voyant le
film en VF, je n'ai pas profité de la subtilité de son phrasé,
mais ai pu goûter à ses mimiques délicates et rigolodes de
bout-en-train (c'est pas ma faute c'est celle de l'UGC). Et c'est
fort bien, car le comique de geste est très présent, même s'il
rime souvent avec répétition, de la partie de cache-cache à la
course-poursuite, avec Hugo comme avec d'autres drilles sans
domicile.
 |
| Train de face + 3D = "effet wow" ? |
Conclusion : Une histoire
d'amour cinématographique
Ce
serait faire mentir le réalisateur d'omettre que tout part de la
bonne intention de rendre hommage à Méliès, et plus largement, au
cinéma des frères Lumière. En filant la métaphore de l'Arrivée
du train en gare de la Ciotat pour la faire parvenir à la 3D
d'aujourd'hui, Scorsese défend son bout de gras et alimente son
argumentaire par un enrobage de film de Noël bien illusoire.
Frelaté, même, j'aurais envie de dire, tant le backgroud
scénaristique et contextuel fait gadget à côté de l'hommage
tonitruant à l'inventeur du Voyage dans la Lune. Bilan des courses,
il s'agit d'une mise en abyme panégyrique plutôt emballante si on omet la première partie du film, et qui permet surtout de
rendre à César ce qui appartient à César. Plutôt qu'un film
originellement conçu pour conter l'histoire émouvante (période de
Noël oblige, il faut pleurer dans les chaumières) d'un orphelin à
la découverte de ses origines, Hugo Cabret est donc l'expression de
l'amour sans bornes d'un réalisateur pour un autre qui lui a non
seulement donné une définition du cinéma admirable mais a
également contribué à ce que Scorsese se fasse sa propre
définition en embrassant la carrière de cinéaste.
4/10


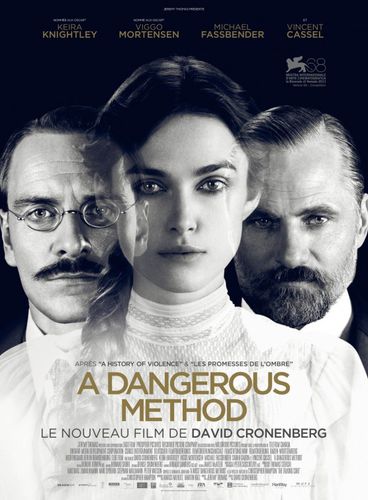













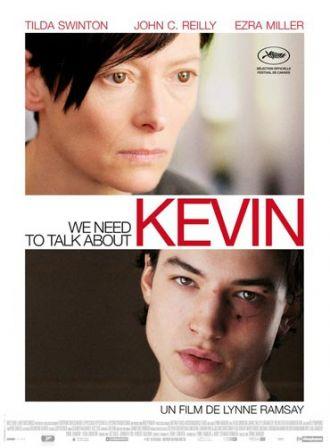
.jpg)