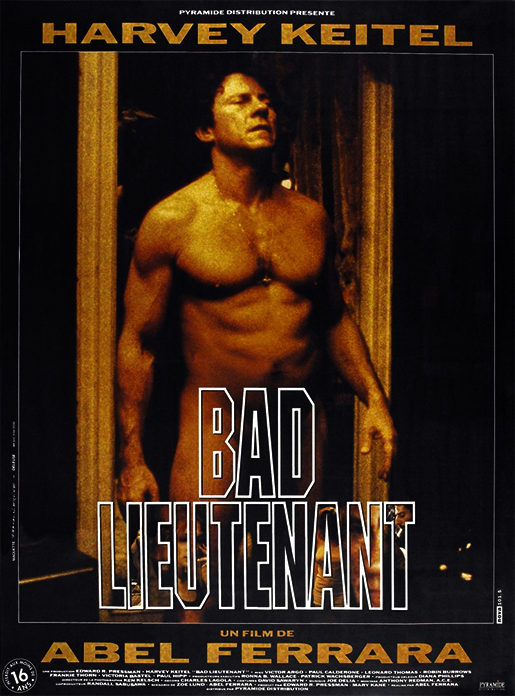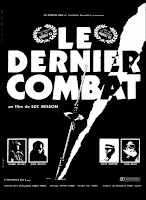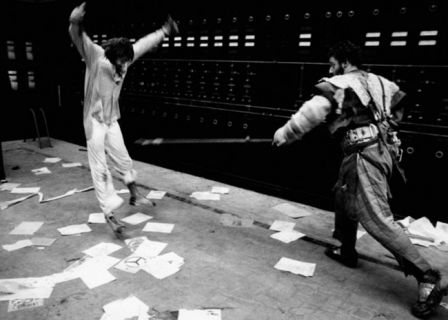Shame.
Après La Piel que Habito
qui le précède de quelques semaines, encore un film qui pose la
psychologie humaine sur l'échiquier du cinéaste pour faire l'étude
d'un spécimen bien particulier, satyr
des temps modernes, et
qui par sa figure archétypale
s'avère pourtant si commun, si répandu, qu'il renvoie au spectateur
sa propre image, blême, avilie, meurtrie. Dégradée, de fil en
aiguille, pour recoudre les morceaux de tissu d'une enfance en
lambeaux... mais stop, je n'en dirai pas plus.
A
vrai dire, ce sont des thèmes connus et reconnus, bien sûr, servis
par des manifestations explicites du mal-être, de l'absence d'estime
de soi, de profonde vacuité d'âme. Tout cela, ce n'est que pour
mieux amener un signifié porté à bout de bras par un signifiant
faisant ressortir une sorte d'essentialisme cinématographique,
reprenant l'expressivité primitive du cinéma muet en l'encadrant de
longues phrases musicales dirigistes... qui ont leur revers, certes,
à l'instar de la scène d'entrée des regards croisés dans une rame
de métro, presque trop « habillée », dès l'accroche,
sans raison apparente, comme si le but était de former une boucle
avec le dénouement.
La
beauté de la réalisation est troublante, terriblement efficace pour
dénoter ce que l'on veut bien y trouver, une fois le sens primaire
du scénario acquis. Si bien que les « orgies du pauvre »
sont ostensiblement sexuées, mais ne sont pas fondamentalement
racoleuses, tout juste purement dérangeantes, affreusement belles.
Érotiques, mais pas érogènes, elles sont l'écho sourd des ombres
de monades urbains qui se frôlent sans s'envisager, se parler, se
connaître, et qui un court instant partagé, fatalement monnayé,
au-delà de l'interface d'une séduction par les mots, se rassasient,
pour combler une faim récurrente et inextinguible.
Ces
scènes de sexe, en ce qu'elles ont de vrai, de cru, ont toujours
tendance à me mettre mal à l'aise. Je ne suis à coup sûr pas le
seul dans ce cas, et c'est bien là tout l'intérêt d'un film qui
doit mettre à mal nos inhibitions pour susciter l'inconfort puis le
dégoût pour choquer, déboussoler, inciter à la réflexion pendant
de longues scènes contemplatives, aux confins d'un « 2001du
cul », souvent tellement esthétiques qu'elles accentuent notre
sentiment de culpabilité... et donc de honte.
En
soi, bien mal serait d'avoir totalement honte, car ce sentiment
purement social, manœuvré, orchestré par un habitus qui dicte les
conduites correctes, n'est pas même respecté des plus puissants,
détenteurs de la morale, ou du moins en surface, le temps d'un
discours édifiant, démontrant une nouvelle fois la fatuité
des mots.
Si
des situations peuvent prêter à sourire dans cette partie de
chasse, c'est parce qu'une situation psychique extrême appelle
conséquemment une emphase de la mise en scène qui me ferait presque
honteusement penser à Requiem For A Dream. L'impasse dans laquelle
se trouve le sujet place l'absurde au centre du drame, appuyé par la
compagnie de sa sœur qui produit un viol de l'intimité et par
conséquent une rupture entre son monde intérieur et le monde
extérieur.
Et
au fond, si l'on peut paraître si cynique, c'est surtout pour se
prémunir d'assauts impudiques au moyen du rempart de la moquerie et
de la distanciation, comme dénonciation arbitraire du vraisemblable.
Heureusement, le cinéma d'auteur fait ses preuves, rigoureusement
détaché du documentaire, travaillé au corps et à l'âme, pour
exprimer une réalité de l'être peut-être trop démonstrative,
mais tellement persuasive...
Aussi,
ce que l'on peut voir comme des longueurs n'en sont pas pour moi. Un
film plus rapide n'aurait laissé le temps de se dire les choses qu'à
demi-mot, de se parler, et de se masturber - comme diraient les
mauvaises langues - que de manière superficielle, sans jouir d'une
interprétation creusée. Être avec soi, en soi, ne pas sortir de
soi, se répandre un instant au dehors, puis retourner en soi. Fixer
les traits de Fassbender, capter des bribes de pensées, d'humeur,
toutes subjectives, pour la plupart certainement fausses... Puis
s'approprier l'autre, pour redevenir soi, et gagner en épaisseur.
Après
Hunger, la Faim, Mc Queen (numéro 2) ajoute un nouveau péché
capital à ses commandements, la Honte, pour frapper un grand coup et
imposer sa vision prophétique du cinéma, sans atteindre le
prêchi-prêcha messianique
et subrepticement racoleur de Malick dans The Tree Of Life. Est-il
temps que le cinéma se mette à nu pour exacerber les courbes d'Eve
et d'Adam ? Serait-ce enfin le signe d'un entrebâillement de la
maturité du cinéma américain départi de l'emprise d'Hollywood ?
Shortbus aura pu ouvrir la voie, d'autres auront su s'en servir bien
plus adroitement. Une bonne appréciation du film, un grand coup pour
l'expérience.
Vous
savez, ce genre de phrases, « vous n'en sortirez pas indemne »,
« c'est le genre de film qui ne laisse pas indifférent »,
vous les entendrez, dans votre tête, dans votre entourage... Et une
fois la piqûre de xanax
administrée, et sans
doute avec beaucoup d'empressement à l'autopersuasion, vous
comprendrez pourquoi.
8/10


.jpg)