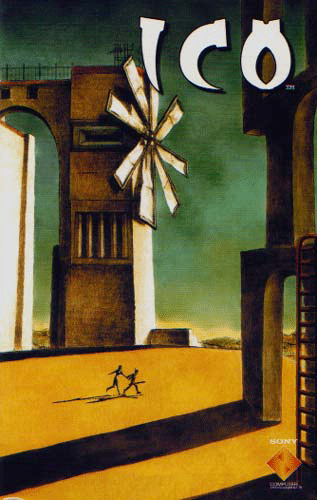jeudi 12 avril 2012
Valkyria Chronicles (CB#1)
jeudi 23 février 2012
GTA IV : The Ballad of Gay Tony (CB#2)
Temps de jeu cumulé : 12 heures
Statut : Histoire finie
Progression : 66.43%
Appréciation finale : 6/10
DU REALISME BADASS
Je parlais de "réalisme" dans mon précédent laïus, mais il faut avouer qu'il s'agit d'un réalisme de perlimpinpin, à peu près aussi réaliste qu'une chronique de Retour vers le futur. Si le réalisme existe, il est essentiellement graphique, et s'inscrit surtout en distingo de gameplays totalement débridés, comme celui de Crackdown, par exemple, enfanté par un parent de GTA : la boucle est bouclée.
On peut parler de "badass", dans le plus pur esprit Gears Of Warien, car l'épisode de Gay Tony joue dans la surenchère vis-à-vis de ses aînés : base jump (saut périlleux avec reprise de volée en parachute), fusillades qui donnent le tempo et le sens du rythme à l'aventure, avec des armes inédites on ne peut plus efficaces, et fort accroissement de la densité de biatches au mètre carré... Mais là je m'égare.
Et là c'est sérieux. Passer de l'un à l'autre peut s'avérer délicat, notamment lorsque le joint n'est pas assez bon pour gommer la redondance des scènes aux airs de déjà vu. Prenez une cinématique suivant un rendez-vous à un point B : celle-ci narre un rendez-vous qui se passe mal et qui transforme la situation en véritable émeute pour les deux acolytes en place. Sauf que rien ne justifie vraiment cette dégénérescence de l'action puisqu'une ellipse (factrice de retournement de situation donc) pas forcément bien sentie a éludé le fait même que l'on est coincé au sein d'un immeuble qui depuis la conversation avortée s'est transformé en guêpier, comme ça, d'un coup, sans crier gare. Un gimmick cinématographique, certes, mais qui rompt momentanément le pacte tissé entre le joueur et les développeurs, celui du quatrième mur invisible, la tête dans le guidon. On appelle ça l'"effet Metal Gear Solid 4" ou "mais elle est où la belle animation !?!".
Mais on n'est pas encore à l'ère de l'hologramme et des jeux 100% motion-capturés, tournés à l'aide d'une caméra 3D, comme le seraient un film en fait, mais à 360 degrés, de A, à Z. Maintenant, vous êtes dans la deuxième "séquelle" de GTA IV, et vous pétez la vitre d'une voiture pour vous y infiltrer, côté passager, avant de faire le tour et de réussir, comme par magie, à entrer côté conducteur, sans pour autant avoir explosé la vitre de la sportive, qui soit dit en passant, aux années 2010, est toujours équipé d'un bitonio pour verrouiller la portière.
 |
| L'objet du crime |
| Avant |
Les modèles de voiture sont par contre toujours aussi agréables à l'oeil, surtout en ce qui concerne les sportives, bien qu'elles soient de grosses imitations à peine dissimulées d'Aston Martin ou de Ferrari. Leur déformation de carrosserie n'aurait de toute manière pas plu aux constructeurs officiels, compte-tenu du leitmotiv de jeux "simu" comme Gran Turismo 5, qui de manière officielle clament le parti pris du "stay clean" pour l'amour des belles voitures de collection, taille réelle, en temps réel (mais virtuel hein, vous me suivez ?) mais qui en réalité ont sûrement des impératifs autrement plus commerciaux, comme respecter l'image de marque d'un fabriquant...
 |
| Après |
C'est la même chose quand il s'agit de nommer des enseignes de magasins ou de faire de la pub pour des chaînes de restauration. 24/7 est par exemple une grosse copie-nette de 7/11, qui n'est non pas la date du plus grand choc des cultures entre les barbus et les imberbes, mais qui est en fait une chaîne de magasins du genre de ceux qui ne ferment jamais l'oeil, que ce soit de jour ou de nuit, pour le bien de leurs clients, mais aussi de leur compte en banque. Même si GTA aime à se lover dans la parodie, on est ici plus proche d'un pastiche assez évident. En tout cas, il n'est pas le seul, et en analyser les principaux demanderait tout un dossier.
Brucie, Roman Bellic, Billy Grey des Angels Of Death, et j'en passe pas mal... Tout comme des lieux, évidemment, des situations qui évoquent le renouveau de Liberty City du quatrième volet, à l'image de cette première cinématique où tout est dit : on y aperçoit Nico Bellic au volant d'une berline de mafieux, toujours la gueule barbouillée de poils vieux de trois jours. Et cela ne s'arrête pas au clin d'oeil, car on recroise souvent ces personnages bien connus au cours de l'aventure, en éclairant ainsi un peu plus le joueur sur les événements du jeu, étant donné que les deux "stand alone" de GTA IV se passent en même temps que le jeu d'origine. C'est ainsi qu'une mission comme "Not So Fast" réunit en une succession de plans les trois personnages emblématiques de chaque épisode : Nico Bellic, Johnny Klebitz et Luis Fernando Lopez. Plus que tout autre, ce dernier épisode est emblématique de l'art cinématographique du croisement de portraits, comme aime à le pratiquer Inarritu.
THE BALLAD OF GAY TONY, PÈRE SPIRITUEL DE DRIVE ?
Vous avez vu le blouson de Luis, maintenant écoutez ce thème musical servi dans le menu principal, lorsqu'on met le jeu en pause. J'y retrouve ce même calme discoïde post douche au vin blanc, qui dénote les années 80 et les boîtes qui retiennent la nuit. Et si ce n'était que ça... A la moindre encablure de pont, lorsqu'un hélicoptère me surplombe et qu'il faut que je m'engouffre dans une rue étroite au lieu de suivre la voie rapide, je m'imagine au volant de la carpe de Drive... Et me revient alors le moindre détail "jeuvidéoesque" du film : la fusillade dans l'appartement, avec l'ultraviolence de l'exécution dans la salle de bain, très "Vice Cityesque" dans l'esprit (la tronçonneuse se trouvait dans une salle de bain), mais aussi le look de la rousse ascendant vulgaire toute boudinée dans son jean
On sait que GTA est très doué pour raconter des histoires, et surtout les mettre en scène. Les nombreuses missions annexes, à peine perceptibles pour certains (contenues dans votre téléphone portable, ou déclenchés ponctuellement sur la map) amènent quelques fois de bonnes surprises, en-dehors des sentiers battus des rencontres qui tournent mal et dégénèrent en fusillade.
Ils sont très nombreux, c'est certain, mais ils sont malheureusement mal mis en valeur par le bruit du moteur un peu trop envahissant de votre véhicule, et qui ne peut pas être modulé indépendamment du son des voix. Le son des "effets" est global, point barre, ne cherchez pas à faire votre marché, le son des voix ne peut pas être rehaussé. Espérons que ce sera corrigé avec le prochain épisode.
Pour l'instant, on déguste au maximum ce qui fait la grosse qualité de la série, même si son langage peu châtié de vitrine, pour attirer le chaland "wesh cousin c'est 18+" lui porte quelque-peu préjudice... Mais GTA a de toute manière conscience de ce qu'il est : un divertissement défouloir, et il l'assume comme jamais dans cet épisode. Beaucoup de types de personnes en prennent pour leur grade, et le microcosme "people" de l'Internet est sérieusement écorné, en porte-à-faux des peoples IRL. "Killed by a social network" pour un personnage secondaire qui twitte (avec un autre nom dans le jeu) jusqu'à son dernier souffle, "Je ne veux pas que tu deviennes un connard de blogueur imbu de lui-même", de Tony (le patron) à Luis, toujours en poussant l'exagération pour faire grincer des dents. Allez va, Gay Tony est finalement tellement attachant qu'on ne lui tient pas rigueur de cette jalousie qu'il tient envers ses petits-enfants les stars numériques, dotés de la même ambition, un brin plus lâche, qui a fait la fortune du gay le plus célèbre de la saga GTA.
VERDICT ?
Arriver au bout de la trame principale d'un GTA est toujours un événement en soi, qui lui redore instantanément son blason pour reléguer les critiques de manque de renouvellement et d'approximations techniques au second plan. Il est vrai que j'y ai passé de bons moments et que j'ai parfois trouvé matière à m'extasier, quand j'ai pu me jeter d'un avion, déclencher mon parachute et profiter des merveilles d'une ville illuminée en pleine nuit, assis, en me laissant glisser vers mon point de chute... Mine de rien, ce sont des moments comme ça qui rappellent pourquoi il s'agit de l'arlésienne du jeu vidéo, du fantasme de la liberté totale : pouvoir explorer une immense ville comme on veut, à tout moment, est une promesse à laquelle on a (j'ai, peut-être) trop goûté, et je n'y trouve malheureusement plus la même saveur, même si elle reste démentielle. On pourra arguer que les équipes de développement sont suffisamment nombreuses pour assurer cette quantité de contenu en level design, mais il est difficile de ne pas rester pantois devant cette représentation urbanistique unique et qui à chaque nouveau titre reconfigure sa propre sphère, sur la base d'un gameplay existant, ou sur un tout nouveau moteur, comme ça a été le cas avec GTA IV. GTA III avait fait fort en son temps, avec Liberty City (New York) en fleuron, le IV a repris le flambeau pour changer à la fois d'échelle graphique et métrique.
Il manque à la Ballade du Gay Tony l'élément de surprise graphique qui a pu faire mouche jadis. On n'est plus autant baba, mais peut-être que la cinquième estoc sera l'occasion de faire dans le neuf, et pourquoi pas de réincorporer les éléments de RPG de San Andreas, qui avait fait date en son temps grâce à son audace. On peut bien espérer cela du dernier épisode de cette génération de consoles de salon ?
Parodie de Metal et remake de Piège de cristal dans la mission "Dropping In"
dimanche 19 février 2012
GTA IV - The Ballad Of Gay Tony (CB#1)
Mode : un joueur
Un peu de tautologie
 |
| GTA Meets Batman http://deadendthrills.com/?tag=open-world |
mercredi 15 février 2012
Pepsi Invaders : La vérité est ailleurs
Développeur : Atari
On est ici à la limite de la régulière, entre le jeu "hommage", "clin d'oeil", et l'advergame bâtard. La publicité n'est pas claire en soi, puisqu'il s'agit avant tout de faire du mal à Pepsi en lui faisant du bien, soit lui faire de la pub tout en voulant démolir son image, voire le démolir, au sens propre du terme, à la place des aliens du jeu original.
vendredi 23 décembre 2011
Star Wars Jedi Knight 2 : Jedi Outcast (CB#2)
Ajoutez à ça que j'ai connu pas mal de bugs d'affichage qu'un PC aux drivers récalcitrants ne renierait pas : un couloir sombre bariolé de vert fluo devient soudainement orange, teinté de trous noirs inexplicables...Une autre fois aussi, sans explication aucune, je faisais demi-tour sur une passerelle, et alors même qu'aucun trou visible n'était présent, mon perso s'est vu choir pour s'écraser au sol comme un mannequin.
Du Chiffre (d'affaire) aux chiffres...
D'ailleurs, pour revenir à l'UFC... C'est quand même honteux de voir quels moyens ont été employés pour intenter une action en justice contre les éditeurs. Pas qu'ils ne le méritent pas pour certains, mais faire cela sur un panel d'environ 500 personnes, cela reste sévèrement poussif... Comme globalement toutes les études qui sont faites dans le monde concentrique du jeu vidéo. Entendre dire par Bertrand Amar, dans le dernier podcast de Gameblog (décidément), que tous les joueurs, sans exception, ont été bluffés par la Vita et qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est pouvoir l'acheter, me laisse plus que dubitatif. Sachant qu'il a mené son "étude" sur un salon (Le Paris Games Week) où les gens qui étaient prêts à faire la queue (plus ou moins grande) étaient au plus tout acquis à la cause de Sony, au moins curieux de voir la descendante de la PSP (ce qui implique qu'ils aient un rapport cordial avec la console), biaise tout de suite les chiffres. Si l'on imagine également que ce public qui se déplace pour aller dans de grands salons jouer aux dernières nouveautés pour la plupart pas encore sorties, on peut se faire une petite idée de la catégorie (quand même assez restreinte) de joueurs qui ont fait le déplacement et mis leurs mains sur la machine : les gamers, quasi purs et durs. Alors, évidemment, dit comme ça, ça peut paraître réducteur, mais je pense qu'il faut prendre en compte de nombreux paramètres avant d'avancer des thèses pareilles, même si ici cela n'a pas grande incidence, contrairement à certains cas où c'est carrément la reconnaissance du média qui prend appui sur des chiffres qui sortent d'on ne sait où ; comme dans le cas de la proportion de filles/femmes américaines tâtant de la manette.
Bref, c'est mal pensé, pas assez fun et vraiment fait pour contenter le fan sans trop caresser le joueur dans le sens du poil. C'est dommage, car d'autres jeux de la licence comme Episode 1 Racer (ne parlons pas de La Menace fantôme...) ont beaucoup mieux vieillis.
Les QTE sont un bon exemple de ce qui a pu être fait en terme de mise en scène pour réveiller le joueur. Et je ne suis pas hors-sujet en parlant d'elles. On peut parfaitement les faire entrer dans la danse par leur simple nature d'aide contextuelle, de renseignement précieux sur les actions à mener pour débloquer une situation périlleuse. Shenmue en a été l'instigateur, le maître étalon, et la folie ne s'est pas arrêtée depuis. Non seulement c'est une nouvelle définition de l'interface de jeu, mais aussi une manière de dynamiser une narration qui rompait terriblement avec la position active du joueur pendant les phases de jeu. Passant pour des parenthèses au jeu, les cinématiques en images de synthèse permettaient de souffler, d'en prendre plein la vue sans vraiment écouter, en reposant son cerveau un court instant. En faisant passer les cinématiques au temps réel par le biais d'un moteur graphique plus abouti qu'aux débuts de la narration cinématique (FF7), les QTE ont fait leur percée pour réveiller le joueur et l'impliquer à l'endroit même où il avait pris l'habitude de la détente. A mon avis, ce n'est que pour mieux le rendre concerné par une intrigue qu'il pourrait facilement délaisser en ne la regardant que d'un oeil ou tout bonnement en passant la cinématique par la pression du bouton A/X ou Start. Pour les développeurs, les créateurs et les éditeurs à l'origine d'une brochette de personnages formant des sagas (Nintendo), c'est une manière de rendre honneur au travail effectué par les scénaristes, qui ne sont bien souvent pas les plus plébiscités, et cela peut se comprendre compte-tenu du manque de prise de risque dont peut souvent souffrir le média...
Un bon con(texte) pour sauver la mise
Des énigmes ? Du foutage de g...
La plateforme s'exporte bien
Je retiendrai que le périple permet quand même de voir de beaux lieux de la mythologie de La guerre des étoiles, d'un point de vue plus appréciable que celui des "shmup" Rogue Squadron. Souvent, les escapades à gambettes de Jedi permettent même de se remémorer de bons moments passés à presser la touche pour s'accroupir en plein saut de voltige. Réflexe d'Half-Life, conservé avec Counter-Strike ? Utile, car fonctionnel pour gagner quelques micro-mètres. Et sur CS, quelles maps représentaient le mieux cette folie du "parkour" (avant même Mirror's Edge) ? Les KZ (maps de sauts, ou "jump maps"), à ne pas confondre avec les DE (maps à bombe) et les CS (maps à otages). Je subodore que l'acronyme KZ vient du nom de leur fondateur : Kreedz. Cette théorie est relayée par pas mal de pages du net mais je ne serais pas étonné que l'acronyme ait un autre sens...
mercredi 21 décembre 2011
Star Wars Jedi Knight 2 : Jedi Outcast (CB#1)
 Tout à l'heure, en jouant à ce produit estampillé LucasArts, je me suis dit que les limitations techniques inhérentes à une plateforme et surtout à une génération de consoles de salon, comme celle des 128 bits dans le cas présent, peuvent nuire à l'immersion et même à la progression dans les niveaux. Alors qu'on pourrait croire que Jedi Knight 2 n'est qu'un vulgaire FPS pas bien dégrossi et mal inspiré (la vérité n'est pas bien loin de toute façon), il s'inspire aussi de concepts utilisés dans les jeux à la troisième personne, dits "objectifs".
Tout à l'heure, en jouant à ce produit estampillé LucasArts, je me suis dit que les limitations techniques inhérentes à une plateforme et surtout à une génération de consoles de salon, comme celle des 128 bits dans le cas présent, peuvent nuire à l'immersion et même à la progression dans les niveaux. Alors qu'on pourrait croire que Jedi Knight 2 n'est qu'un vulgaire FPS pas bien dégrossi et mal inspiré (la vérité n'est pas bien loin de toute façon), il s'inspire aussi de concepts utilisés dans les jeux à la troisième personne, dits "objectifs".  Quand même, j'ai beau passer à autre chose, je peux pas m'enlever de la tête que Star Wars s'évertue à décupler la mythologie chrétienne, en déclinant les figures christiques/monacales au travers des chevaliers Jedi, barbus, drapés d'une toge, répandant pour les plus aguerris la fameuse bonne parole "Que la force soit avec toi" qui me fait penser au non moins célèbre "Que la paix soit avec vous". Le plus sage est le prophète, couvert d'un vêtement qui le dissimule aux yeux des autres (qui a dit Mahomet ?) tout en le distinguant du jedi lambda, apprenti, drapé de beige, comme symbole de "pureté" qui s’entache au fur et à mesure, dans un même ordre d'idée que les ceintures d'arts martiaux comme le karaté et le judo. Yoda ne ferait-il d'ailleurs pas un bon karatéka ? Entre l'habit de moine et le kimono, il n'y a qu'un pas...
Quand même, j'ai beau passer à autre chose, je peux pas m'enlever de la tête que Star Wars s'évertue à décupler la mythologie chrétienne, en déclinant les figures christiques/monacales au travers des chevaliers Jedi, barbus, drapés d'une toge, répandant pour les plus aguerris la fameuse bonne parole "Que la force soit avec toi" qui me fait penser au non moins célèbre "Que la paix soit avec vous". Le plus sage est le prophète, couvert d'un vêtement qui le dissimule aux yeux des autres (qui a dit Mahomet ?) tout en le distinguant du jedi lambda, apprenti, drapé de beige, comme symbole de "pureté" qui s’entache au fur et à mesure, dans un même ordre d'idée que les ceintures d'arts martiaux comme le karaté et le judo. Yoda ne ferait-il d'ailleurs pas un bon karatéka ? Entre l'habit de moine et le kimono, il n'y a qu'un pas... lundi 19 décembre 2011
Ready 2 Rumble Boxing Round 2 (CB)
Main - manette : rencontre du troisième type

Se prendre au jeu du jeu
dimanche 20 novembre 2011
Splinter Cell : I'm the Fisher man
jeudi 20 octobre 2011
Batman Arkham Asylum : Batman de coeur
dimanche 25 septembre 2011
Le chaînon débile entre De Chirico et Ico
jeudi 15 septembre 2011
Every Day The Same Dream : Un jour sans fin
samedi 6 août 2011
Final Fight : "C'est la luuuu-te finaaaaale"

samedi 28 mai 2011
Brothers In Arms : Hell's Highway, OU Band Of Recon ?


vendredi 6 mai 2011
Call Of Duty : Modern Warfare 2

L'IA est ce qu'on peut appeler « inégale », quand elle n'est pas excessivement scriptée. En gros, elle est capable du meilleur comme du pire : tourner sur elle-même pour partir dans la direction inverse sans raison, ou nous prendre par surprise en nous contournant. Evidemment, ces moments de solitude sont les plus rageants. Ce qu'on appelle l'IA n'est donc pas mauvaise, mais souffre de disparités trop voyantes. Heureusement, la plupart du temps les comportement sont suffisamment bien réglés pour faire illusion.
Pas à une inégalité près, il en va donc de même de la difficulté : certains passages sont tellement ardus (la scène de l'« écran de fumée » avec l'assaut des hommes en blanc). Inégal aussi en terme de destruction des décors : les écrans y passent le plus souvent, mais il est effarant de voir qu'une simple ampoule résiste à une salve de balles. Réalisme, quand tu nous tiens !
La mise en scène n'a rien à envier aux Block-nanars Hollywoodiens, c'est déjà ça. Les aspects plus tactiques de contrôle d'un drone ou … sont un vrai régal. Tellement bovin dans le doublage qu'il pourrait être estampillé « Tom Clancy ». Et en parlant de ça, ce ne sont pas les missions de pseudo-infiltration qui me feront mentir ! A force de vouloir trop aller dans la démo, MW2 passera définitivement pour un jeu risible bourré de clichés servis au premier degré, et sera montré comme le mauvais exemple parmi toute une nouvelle école du jeu vidéo déjà bien active. Ou alors je me fais prophète aigri de mes deux...
Je ne cracherai pas sur la durée de vie car je pense toujours qu'elle est plus qu'honorable pour un joueur moyen qui aime prendre son temps. Entre les joueurs et les testeurs pros, il y aura toujours un monde... Comme entre les cyclistes du Tour de France et ceux du dimanche si j'puis dire...
Alors, si on tient à l'instant présent : c'est joli, c'est jouable, spectaculaire et on a très envie d'y revenir pour clore l'aventure, mais il est certain que le Gameplay n'est pas assez solide pour survivre à la concurrence des petits frères...
Des orchestrations à la Dark Knight, comme on en voit partout dans les films d'action/espionnage où la tension face à l'ennemi caché/intérieur/nocturne est palpable. A jouer en commando ou en vétéran pour ne pas se griller trop vite la fin. Après tout... Il fallait bien que le FPS ait son Fifa : A conserver au frais pendant 1 an, à consommer rapidement après ouverture... Puis bon à jeter dans les VG et les bacs à Game. N'est pas Portal qui veut, n'est-ce pas ?
mercredi 4 mai 2011
Star Wars Episode I : Racer

Même si la difficulté va crescendo, elle reste néanmoins en deçà de celle imposée dans les épisodes de F-Zero si jamais on a le courage d'en voir le bout. C'est surtout parce qu'il est résolument destiné à un public plus jeune, à l'instar du film dont il tire son nom et son univers.
Certains circuits ont un taux honteusement bas d'images par seconde (framerate en carton, comme on dit), même avec un Expansion Pak. Les pistes sont trop larges pour que la sensation de vitesse ne se perde pas en route, même en vue de cockpit. La répartie sonore du pod manque d'ampleur, et se cantonne à des vrombissements douteux d'aspirateurs, loin des envolées palpitantes du film, qui faisait vraiment croire à une course de F1.
A côté de ça, l'aspect RPG de gestion des améliorations du pod est très bien venue, et augure d'une marge de progression ainsi qu'une rejouabilité plus que sympathiques.
Bien mais pas ultime comme tout le monde s'acharne à le dire, SW Racer souffre de la trop grande concurrence en matière de course futuriste sur cette même console : entre les XG, le WipeOut 64 et F-ZeroX, il y a largement de quoi faire...
lundi 11 avril 2011
F-Zero GX : Sans concurrent aucun.
Dès les premières parties, le jeu d'Amusement Vision et Sega s'avère méga fun et pas vieilli pour un sou inséré dans la borne. Sur l'écran titre, ce n'est pas un, ni deux, ni trois, mais une dizaine de menus qui sont à portée de pouce. Parmi eux, le mode grand prix est la pierre angulaire et les modes Story et Time Attack s'articulent autour.
Pour résumer, F-Zero est un peu le jeu de F1 futuriste destiné aux hérétiques des jeux de course. Connu pour sa difficulté, le jeu de course survitaminé de Nintendo traîne une réputation pas déméritée. Technique, c'est typiquement le genre de jeu à challenge. Il est facile de le finir d'une traite en le bouclant en Easy, mais difficile à maîtriser en Hard et même carrément impossible à finir à 100% tant le mode Very Hard porte bien son nom... De bout en bout, le challenge est relevé, jusqu'à l'ultime course des quatre coupes, aux couleurs aussi clinquantes et décalquées que celles de la Route Arc-en-ciel des Mario Kart.
Pour parler Gameplay, les sensations de vitesse sont très bonnes, même si certains circuits bourrés de lignes droites les atténue. Toutefois, l'enchaînement des courbes et virages serrés fait griser les mimines et les neuneus du Rhône à plein gaz. L'utilisation des gâchettes et du stick sont la parade d'une vitesse furieuse assez bien rendue à l'écran pour faire avaler la couleuvre de la vitesse pipotée affichée au compteur.
Encore à l'heure actuelle le dernier épisode de la série, j'attends de pied ferme le petit frère sur 3DS, de préférence. F-Zero GX se picore avec plaisir, si bien que petit à petit on en dévore la quasi-intégralité, avec une marge de progression sans cesse croissante. Alors non seulement GX est fun, mais il est également gratifiant. Rarement un jeu au gameplay aussi millimétré aura autant flatté le joueur à mesure qu'il s'y adonne. Alors si en plus de ça c'est un des seuls jeux Gamecube à jouer (aussi bien) dans cette catégorie, que demander de plus ?
lundi 14 mars 2011
Doshin The Giant : Doshin, c'est Géant.

Doshin, c'est surtout un jeu à part. On prend la manette, et on ne comprend rien. On voudrait courir, mais on ne peut pas. Alors on avance, à pas chaland, pas chassés, avec une caméra capricieuse et la douloureuse envie de sauter. Ca y est, la touche enfoncée, on fait un bond, mais le relief s'en trouve enfoncé... Un cratère sous nos pieds, on prend désormais soin de fouler gentiment le sol recouvert de gazon. Les autochtones nous accueillent à bras ouverts, on ne sait trop pourquoi : peut-être parce qu'avoir trois touffes de poils sur la tête et un corps longiligne d'anguille fait de nous un Dieu... Parce qu'on sort de la mère, après tout, alors il faut croire qu'un de nos parents a dû croiser d'un peu trop près le nuage toxique d'Hiroshima lorsqu'il était parti chasser le plancton 20 000 lieues sous les mers. Ma mère, la Terre, mammaire, la plèbe nourricière. Parce qu'on lui rend service, mais qu'elle nous aide en retour : en nous apportant son amour, elle nous fait grossir, enfler et grandir, pour progresser plus vite sur cet archipel désoeuvré où tout est à faire. Ou à refaire ? A refaire, tout un monde à refaire. Merci la musique, qui trotte en tête, et adoucit les moeurs dès le menu principal allumé. On saute sur la première partie venue pour se faire les crocs bec et ongles.
A voir, une limitation : « 40 blocs de sauvegarde ! Tout ça pour ce foutu jeu sorti de nulle part ? ». Mais rassurez-vous/nous/eux/toi+moi+Tousseukilevel, pas de panique, l'expérience nécessite bien tous ces blocs pour sauvegarder la mémoire de notre comportement et de notre apport à la civilisation des hommes, pas foutue de se démerder toute seule lorsqu'il s'agit d'aplanir le relief. Nous voilà arrivés au point intéressant : pouvoir manier grâce à nos incroyables pouvoirs magiques hérités d'on ne sait qui... D'un coup d'un seul, le sol est surélevé ou affaissé. Ah, fessées et poings liés que l'on peut alors leur asséner, à ces manants et vermisseaux qui peuvent crouler sous notre joue dès que le Jashin déclenche sa colère. Mais quel est l'intérêt me direz-vous ? Détruire, intimider, pour le fun, de voir détruit en un quart de seconde tout ce qui a pris tant de temps à être construit, par notre patience et les petits bras laborieux des Mii naquis avant l'heure.